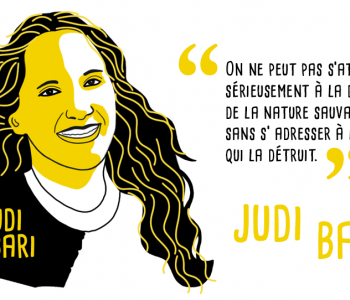Avortement, pouvoir médical et autonomie des femmes
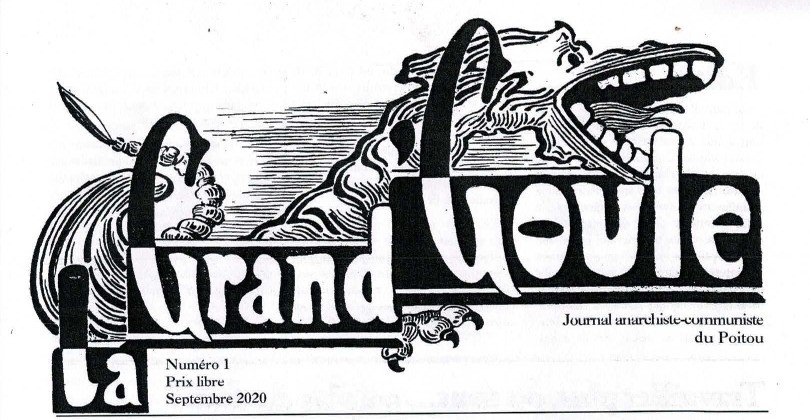
La Grand Goule, journal anarcho-communiste du Poitou, antipatriarcat, anticapitaliste, égalitaire et révolutionnaire. Le premier numéro est paru en septembre 2020 et sa ligne éditoriale est sans ambiguïté : « Pour une société sans classe et sans État, basé sur l’égalité économique et sociale, dans laquelle chaque communauté humaine s’organise, vit, produit, échange, décide, de manière directe et sans institution intermédiaire. » Il se distribue de la « main à la main » mais est également disponible sur demande : lagrandgoule@krutt.org
La discussion autour de notre vécu commun de femme et la réappropriation du savoir concernant nos corps sont de puissants moteurs de mobilisation féministe. Pendant quelques mois l’an dernier, nous avons été plusieurs femmes à nous réunir à Poitiers pour discuter de nos expériences de l’avortement, de la manière dont on pourrait améliorer sa prise en charge mais aussi donner aux femmes qui désirent avorter des arguments pour faire entendre leur choix face aux médecins. Le questionnement s’est évidemment étendu à la possibilité d’une autre pratique, plus libre, de l’avortement.
La lutte pour la légalisation de l’avortement est fréquemment prise comme exemple d’une mobilisation jugée victorieuse. A partir des années 1950 et jusqu’à la fin des années 1970, des mouvements de femmes s’organisent et revendiquent la dépénalisation de l’avortement. Concrètement, il s’agit d’obtenir l’abrogation de la loi de 1920 qui criminalise l’avortement, le rendant passible de la peine de mort (cette peine n’ayant été appliquée à des avorteuses que sous le régime de Vichy). La lutte se porte évidemment sur plusieurs plans, à la fois légalistes et illégalistes. Parmi ceux et celles qui pensent que ce n’est pas en recourant aux institutions qu’on obtient les meilleurs résultats, des groupes de militants se mettent à pratiquer des avortements clandestins dès le début des années 1970. Il s’agit, pour elles et eux, à la fois d’aider concrètement les femmes devant la difficulté d’avorter, mais aussi de démontrer la fiabilité et la quasi-innocuité de la technique par aspiration employée (dite méthode Karman, qui vient d’être mise au point à l’époque aux États-Unis). C’est cette lutte par la pratique de l’avortement autonome et donc non contrôlé par l’État, massivement soutenue par le Mouvement de libération des femmes et une grande partie de la population, y compris de la classe politique, qui a encouragé le gouvernement à légiférer sur la question afin de reprendre la situation en main, les femmes organisées lui démontrant qu’elles avortaient de toute manière, qu’on le leur autorise ou non.
Cette lutte débouche sur la loi Veil, promulguée en 1975, qui légalise la pratique de l’avortement par des médecins (elle évoluera ensuite jusqu’en 2016, année à partir de laquelle l’« avortement médicamenteux » devient prescriptible par des sages-femmes). Depuis lors, l’avortement est un acte qualifié de « médical » et, comme tel, sa pratique n’est autorisée que pour les membres du corps médical. Ainsi, la pratique d’un avortement hors de ce cadre est passible de poursuites pour « pratique illégale de la médecine ». Nous n’avons aucune certitude à ce sujet, n’ayant pas connaissance de précédents judiciaires de femmes poursuivies pour avoir pratiqué un auto-avortement. La mainmise du corps médical sur l’avortement provoque néanmoins une dépossession, de fait ou légale, qui décourage probablement nombre de femmes de tenter de le faire elles-mêmes ou, pour celles qui le font, les encourage à rester dans la clandestinité. L’avortement n’est donc pas libre : il est encadré par la loi. Du côté de la dépénalisation de la femme avortée, la loi de 1920 sera finalement abrogée en 1993.
Alors certes, depuis l’application de la loi Veil (au début des années 1980), et les modifications qu’elle a subies depuis (remboursement de l’avortement par la Sécurité sociale, ouverture de ce droit aux mineures et étrangères, etc.), l’accès à l’avortement n’est plus réservé à celles qui ont les bons contacts, les bons réseaux, l’argent pour le faire pratiquer en France ou pour se déplacer dans un pays limitrophe, et ce n’est plus un acte que l’on pratique dans la clandestinité. C’est donc une amélioration concrète de la condition des femmes. Mais si la légalisation pour les médecins a permis un meilleur accès à l’avortement, nous y avons perdu notre autonomie dans la prise en charge de notre corps, nous-mêmes. Globalement, la légalisation d’une pratique va souvent dans le sens d’un contrôle plus fort des structures sociales ou économiques sur la vie et d’une limitation de l’autonomie des individus. La normalisation des pratiques permet un contrôle plus étroit de l’État sur les personnes, ainsi que des débouchés financiers certains (un accouchement ou un avortement à la maison ne coûtent ainsi pas grand-chose, alors que leur pendant à l’hôpital devient une source de revenu).
La légalisation de l’avortement à la suite des mouvements de lutte des années 1970 n’a pas échappé à cela : il s’agit donc d’une victoire partielle. N’oublions pas en effet qu’une partie des femmes mobilisées pour la liberté d’avorter dans les années 1970 (i.e. le Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception – MLAC) souhaitait que l’avortement ne soit plus considéré comme un crime, ni pour celles qui le demandaient ni pour celles et ceux qui le pratiquaient. Ces femmes souhaitaient que cette pratique puisse continuer d’être effectuée par des femmes expérimentées mais non forcément médecins, sans avoir à recourir à la clandestinité (mais une partie seulement des groupes du MLAC militaient et faisaient pratiquer des avortements par des non-médecins). Une partie de leur lutte visait à en faire un acte faisant partie de notre vie, et donc de notre sexualité et de notre contraception. Les groupes qui luttaient pour l’autonomisation des femmes vis-à-vis de leur corps ne souhaitaient évidemment pas qu’une nouvelle loi vienne encadrer cet acte.
Cela fait maintenant quarante-cinq ans que l’avortement est légal en France. Et si sa pratique s’est démocratisée et s’il n’est pas remis en cause par des mouvements de masse, il n’est pas, par contre, devenu partie intégrante de la vie, et ce n’est pas souvent une opération traversée en toute sérénité. Pourtant, comme nous l’avons déjà brièvement exposé plus haut, c’est un acte qui peut être pratiqué de manière très facile (sans anesthésie générale et avec un matériel très simple, pour la technique par aspiration notamment). Ce qui en fait un passage souvent compliqué n’est donc pas tant l’acte en lui-même que sa prise en charge dans le cadre de la médecine conventionnelle. Dans ce cadre-là, nous remettons notre corps entre les mains de spécialistes qui prennent rarement le temps de l’explication, qui ne tentent pas (ou n’ont pas le temps) de nous impliquer dans l’acte qu’ils pratiquent. Et cela dans le meilleur des cas, quand nous ne nous retrouvons tout simplement pas face au refus du médecin de le pratiquer pour « clause de conscience ».
La méthode Karman avait été développée pour être simple, et praticable par des gens expérimentés mais non médecins. C’est cette méthode par aspiration qui est aujourd’hui effectuée à l’hôpital sous le qualificatif impressionnant d’« avortement chirurgical ». La prise en charge de cette technique par le corps médical l’a surmédicalisée, ce qui est justifié par la peur de l’accident éventuel, et la croyance selon laquelle la « sécurité » est augmentée par le degré de technicité. Le refus de prendre le moindre risque induit une normalisation des pratiques et des gestes médicaux intrusifs qui produisent des souffrances alors qu’ils ne sont pas nécessaires. Nous ne nous leurrons pas non plus sur le fait qu’aujourd’hui nombre d’actes sont effectués pour des raisons économiques, et non par réel besoin pour mener la pratique à bien. Plus on fait d’actes médicaux, et plus ils sont techniques, mieux l’hôpital qui les pratique sera rémunéré. Une telle logique ne permet pas de simplification de la prise en charge médicale.
La question de la pratique et de l’accompagnement de l’avortement posée dans les années 1970 a trouvé une réponse légale, et de ce fait, au lieu de continuer d’être traitée comme une question à améliorer sans cesse (il y a peu de chances qu’aucun système soit à jamais parfait pour tout le monde, ni à toutes les périodes), elle a été figée par la loi. Actuellement, cette absence de questionnement sur la manière dont nous souhaitons accompagner les femmes qui avortent, socialement, mais aussi le fait que ce « problème » est traité comme une « maladie » par des « médecins spécialistes » font de l’avortement un cheminement solitaire de la « femme concernée » dans lequel la place des hommes a été annihilée. Nous avortons seules dans notre grande majorité.
Nous sommes inquiètes de constater qu’avorter est légal, mais que ce droit dépend du bon vouloir de l’État et du gouvernement en place, en plus d’être freiné par l’utilisation par les médecins de la clause de conscience spécifique à cet acte pour le pratiquer ou non. Si ce droit nous était retiré, nous nous retrouverions démunies face à cette pratique que nous ne maîtrisons pas.
Cette lutte est donc toujours politique et d’actualité : l’avortement devrait être un acte dont la maîtrise n’est pas laissée aux seuls médecins. A minima, les sages-femmes, qui peuvent déjà pratiquer les IVG médicamenteuses, devraient pouvoir faire les avortements par aspiration, avec un outillage simple, et un encadrement humain, contrairement à ce qu’il se passe en cadre hospitalier. De plus, les femmes auront toujours tendance à avorter par elles-mêmes pour diverses raisons. Nous souhaiterions que, quand elles choisissent cette voie, elles n’aient plus à le faire dans la clandestinité, ce qui les empêche de discuter ouvertement des pratiques, différentes peut-être aux différents stades de la grossesse, et de les faire évoluer.
Finalement, pour se sortir les pieds des étriers, il n’y a pas 50 façons : il faut connaître nos corps, comprendre nos cycles, les effets des différentes techniques employées, la nécessité ou non de certains gestes, pratiquer nous-mêmes l’autogynécologie, l’auto-auscultation, et développer des contextes favorisant notre propre prise en charge de cet acte. Le suivi de la bonne santé de nos corps est pour l’instant dans les mains des médecins, des gynécos, souvent pour le pire, rarement pour le meilleur. Il est indispensable que nous nous organisions collectivement pour récupérer ces savoirs afin de pouvoir porter attention à nos corps, nous-mêmes.
Camille.